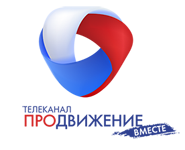+33(0)1 48 59 06 54
+33(0)6 60 46 42 81
chricog@free.fr
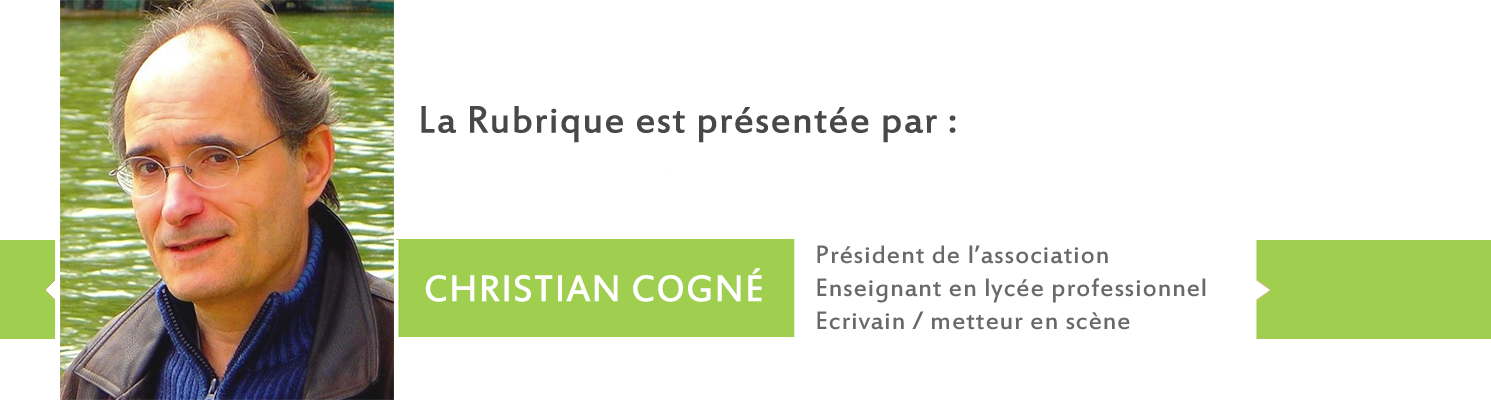
Peut-on parler, aujourd’hui, en France, lorsqu’il s’agit des lycées professionnels, d’un Tiers Monde de l’éducation ? Christian Cogné*
L’image que nous avons de la filière professionnelle n’est guère encourageante. Celle d’un lieu de relégation sociale. On parlait à une époque de voie de garage. Aujourd’hui, on en parle très peu. Presque rien dans la presse. Pourtant, au fil des années, il y a eu des réformes et les toutes dernières sont très importantes pour l’avenir des jeunes. Un jeune prof parisien évoque dans un livre son expérience dans les lycées ou collège de banlieue, il passe à la télévision, vend quelques milliers d’exemplaires et change assez rapidement de métier. C’est exotique. Mais le témoignage d’un prof de lycée professionnel, c’est rare, voire inexistant.
La voie professionnelle reste un accident de parcours. Contrairement à l’Allemagne où le travail manuel par exemple fait partie de la formation intellectuelle, en France il est dissocié. Il y a l’intelligence concrète et abstraite. Or, grosso modo, un élève sur trois en France emprunte la voie professionnelle. En arrondissant, 700000 contre 1400000 en lycée général. Peut-on parler d’un Tiers Monde de l’éducation ?
Au début du siècle dernier. Il y avait ceux qui défendaient un apprentissage en entreprise. Les jeunes devaient de conformer aux valeurs patronales. Et puis ceux qui soutenaient le rôle de l’école dans la formation du citoyen. Ils militaient pour la reconnaissance du diplôme. Ce sont ces derniers, qu’on a appelé les scolaristes, qui ont triomphé aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. On créa alors les CET (Collèges d’enseignement technique), les LEP en 1975 et les LP (Lycées professionnels) en 1985. Le CAP, qui sera supprimé au profit du BEP, restera l’emblème des syndicalistes qui combattaient l’idée d’un apprentissage exclusivement en entreprise.
Après la guerre on pouvait encore parler d’émancipation ouvrière par les études. Un esprit d’éducation populaire flottait ici et là… Une éducation pratique et théorique à l’humanisme et à la démocratie. Rappelons que l’éducation populaire constitue la base d’une société démocratique. C’est-à-dire une société qui se soucie de l’autre et de l’intérêt général, et qui ne sombre ou ne se complaît pas dans les extrêmes, mais s’implique avec circonspection dans les débats citoyens et politiques. Il est important de le signaler car aujourd’hui une société qui fermerait les yeux sur cette éducation populaire serait un colosse aux pieds d’argile. C’est peut-être ce qui fait peur aujourd’hui : On tangue, on vacille… Un médiateur de la République (Jean-Paul Delavoye de l’UMP) parlait de société fracturée, usée psychologiquement… les gens, dit-il, veulent tout et tout de suite, il n’entrevoit plus les règles du vivre ensemble. Sans éducation populaire ou sans éducation tout court qui vise l’intérêt général, nous perdons pied rapidement.
J’enseigne depuis une trente-cinq ans en lycée professionnel et je me rappelle les années où les enseignants d’atelier étaient d’anciens ouvriers ou des compagnons formés dans les ENNA (Ecoles normales nationales d’apprentissage) dont la devise à partir de 1954 était de former l’homme, le travailleur, le citoyen. La transmission des savoirs se faisait par le biais de la solidarité ouvrière. Une solidarité qui était palpable entre les élèves et les professeurs d’atelier. Peu à peu, les écoles normales nationales d’apprentissage ont été remplacées par les Instituts universitaires de formations des maîtres en 1991.
La disparition des ENNA sonnera le glas de cette culture professionnelle et du projet d’émancipation sociale. En effet, il est demandé aux candidats de passer le CAPET ou le CAPLP. Ainsi, ce ne sont plus d’anciens ouvriers ou techniciens qui enseigneront mais des jeunes profs promus au concours, sortant de BTS ou de licence, ayant peu ou jamais eu de contact avec l’entreprise et qui enseigneront pourtant toute leur carrière une discipline sans une réelle connaissance du terrain. Dans ces conditions, le contact entre les jeunes issus des couches populaires et l’enseignant est qualitativement différent.
Cette classe dite populaire a d’ailleurs fondu peu à peu dans l’indifférencié, l’indistinct. Elle a été requalifiée en jeunes de banlieue, voire racaille de banlieue. Dans les années 90, on parlera moins d’éducation mais de formation. A l’école, on forme moins des citoyens que des compétiteurs. Quelques intellectuels s’en sont émus. Albert Jacquard écrira à ce propos :
« Pour être soi, en communion avec l’autre, cela suppose en particulier de lutter contre la compétiton (…) qui consiste à dire : je te regarde et je vais te dépasser, je vais te détruire, je vais te dominer. Cela ne sert à rien, si ce n’est se détruire soi-même. Le ver est dans le fruit de la société occidentale, c’est cette prétention qu’il y a d’enseigner aux enfants qu’il faut réussir en tant qu’individu, réussir plus que les autres, courir plus vite, devenir PDG (…) A quoi cela sert ? C’est un suicide. C’est cela qu’il faut dire aux enfants. »
On constate que les élèves dans les lycées « protégés » ont bien intégré cette compétition alors que les élèves dans des lycées « moins protégés » de banlieue, a fortiori dans les lycées professionnels, ont intégré l’échec comme postulat « je ne suis pas fait pour les études ». L’absentéisme est considérablement plus élevé en lycées professionnels qu’en lycée général. Mais tout cela ne suffit pas à expliquer pourquoi le projet d’émancipation des classes populaires a échoué. Il y a d’autres causes : La crise économique dès 1974, la massification de l’enseignement, le collège unique…
Le collège unique ? Quel rapport avec le lycée professionnel ?
La plupart des élèves en lycée professionnel sont orientés en LP par défaut. Ils sont issus pour la plupart des classes les plus défavorisées de la société.
 Ils ont échoué au collège, ils n’ont pas une folle envie de devenir des secrétaires, des comptables ou des vendeurs, l’orientation en LP est souvent vécue comme une punition, un purgatoire qui les mènera nulle part. Ils ont l’impression souvent qu’on leur met « une disquette » quand on leur parle du Bac Pro qu’il faut décrocher coûte que coûte pour obtenir un emploi. Ils savent que le diplôme ne signifie pas dire grand-chose. Il faut aller au-delà : le BTS. Beaucoup quittent le LP avant l’échéance du Bac Pro, pour les autres ils tentent le BTS mais ne se font pas d’illusion. Et puis il y a ceux qui voudraient aller en BTS mais qui ne trouvent pas de place. On distribue allégrement le diplôme bac pro mais l’intendance ne suit pas, il n’y a pas assez de places en BTS. Alors à quoi bon parler de poursuite d’études ?
Ils ont échoué au collège, ils n’ont pas une folle envie de devenir des secrétaires, des comptables ou des vendeurs, l’orientation en LP est souvent vécue comme une punition, un purgatoire qui les mènera nulle part. Ils ont l’impression souvent qu’on leur met « une disquette » quand on leur parle du Bac Pro qu’il faut décrocher coûte que coûte pour obtenir un emploi. Ils savent que le diplôme ne signifie pas dire grand-chose. Il faut aller au-delà : le BTS. Beaucoup quittent le LP avant l’échéance du Bac Pro, pour les autres ils tentent le BTS mais ne se font pas d’illusion. Et puis il y a ceux qui voudraient aller en BTS mais qui ne trouvent pas de place. On distribue allégrement le diplôme bac pro mais l’intendance ne suit pas, il n’y a pas assez de places en BTS. Alors à quoi bon parler de poursuite d’études ?
L’impression d’échec des élèves en LP est toujours là. Cela vient de plus loin, du collège. Le collège unique ne les a pas aidés à surmonter leurs difficultés. Ils se sont chronicisés dans la voix professionnelle. Ils sont arrivés froissés, on les a défroissés, c’est tout et c’est déjà beaucoup. Ils n’ont pas appris grand-chose dans ce brouhaha de classe où les élèves qui veulent réussir subissent l’indiscipline de quelques-uns : ces gosses a-scolaires qui les empêchent de travailler. Au collège, la question se posait de la même façon : comment enseigner un enseignement homogène dans une classe profondément hétérogène ? Depuis 1975, date à laquelle René Haby créa le collège unique, les solutions à cette question ont toutes échoué. Collège unique, collège inique disait-on alors autrefois.
« La République, écrit Philippe Mérieux, a besoin d’une institution scolaire fondée sur l’hétérogénéité maximale » En effet, c’était un facteur d’unité nationale mais on ne l’a pas mené à bien. Un vœu pieu, une ritournelle. En réalité, on a bâti un collège unique selon le modèle du lycée réservé à une élite.On a bien essayé de le transgresser ce collège unique. Le ministère a lancé des actions de soutien, on a maintenu l’orientation en fin de 5è, les classes préparatoires à l’apprentissage CPA qui disparaîtront en 1991. Ceux qui ont promu le collège unique le critiqueront plus tard. La création des ZEP en 1982 marquera un tournant, mais toujours avec un double langage, une opacité qui l’empêche d’être efficace. Les jeunes issus de l’émigration ont été les premières victimes du système. C’est ainsi qu’ils se sont majoritairement retrouvés en LP, avec pour certains la rage dans le cœur et l’envie d’en découdre avec les profs qui symbolisaient l’institution. Evacués d’urgence du collège dans les LP, qui deviennent davantage des soupapes de sécurité au système qu’une propédeutique à la voie professionnelle.
Qui sont ces jeunes qui s’inscrivent en LP ? Comment ont-ils évolué en quelques années ?
Il y a ceux qui voudraient apprendre un métier. Ils ne sont pas très bons en matière générale mais ils sont volontaires. Ceux-là seront vite découragés par des élèves qui arrivent en LP par défaut, qui ne sont pas motivés, quelquefois a-scolaires. Hélas, le prof qui a des classes hétérogènes ne peut assurer qu’un enseignement nivelé par le bas. Il doit sans cesse faire de la discipline. C’est environ 50% de son occupation en classe.
De 1970 à la fin des années quatre-vingt, parmi les élèves qui viennent en LP, il y a les caïds. Il fallait de composer avec eux pour avoir la paix. A Champigny où j’enseignais c’était des bandes qui se déplaçaient en lycée professionnel, les élèves venaient pour la plupart de la Cité du Bois L’Abbé qui n’avait pas bonne réputation. Ils avaient des codes, des limites à ne pas franchir, bref l’ébauche d’une organisation, fondée parfois sur le sens de l’honneur. Une négociation avec les caïds était possible. Négocier, parlementer c’était une règle de survie.
Dans les années 90, brusque changement de tonalité. Nous n’avons plus les mêmes élèves. A la dynamique des groupes avec ses codes se substitue une masse d’individus sans aucune solidarité entre eux. Des élèves en LP issus pour la plupart de l’émigration et complètement atomisés. Un public plus immature, impulsif, voire incontrôlable. L’engouement pour les marques Nike, Adidas, Reebok avait fait naître une génération de jeunes prédateurs. Des jeunes en LP venaient avec des billets de retard. Lorsqu’on leur demandait pourquoi ils arrivaient systématiquement en retard ou séchaient les cours ils répondaient qu’ils partaient à la chasse. Par petits groupes de 4-5, dans le métro parisien, ils repéraient un gosse des « quartiers riches », griffé Lacoste ou autre, le suivaient, l’encerclaient puis le dépouillaient. Ce qui était surprenant c’était l’absence de moralité de ces jeunes qui se vivaient comme des guerriers urbains. Au credo « j’achète donc je suis », se substituait un je te dépouille donc tu n’es plus » Un nouveau style de marketing en fait qui exacerbait les valeurs du courage, de l’héroïsme barbare et auxquelles faisaient écho les slogans Nike Just do it ou Adidas : Impossible is nothing. Ce qui devenait remarquable, c’était l’absence de repères de ces jeunes autre que celui de la cité comme marqueur d’identité. Ce qu’il y avait de nouveau, c’était cette hostilité farouche comme les prolégomènes à une explosion future. Je pense à celle de Vaulx en Velin en 1990.
Quelles sont les causes de ce changement de comportement ?
 Que s’était-il passé pour que les jeunes changent d’attitude à ce point et perdent ainsi tous leurs repères. Il ya de nombreuses causes. Il faut en citer quelques unes et entrevoir cela dans une perspective historique.
Que s’était-il passé pour que les jeunes changent d’attitude à ce point et perdent ainsi tous leurs repères. Il ya de nombreuses causes. Il faut en citer quelques unes et entrevoir cela dans une perspective historique.
« La France c’est comme une mobylette : pour avancer, il faut du mélange. » C’était un slogan populaire de 1983. Pour comprendre sa portée il faut se replonger dans l’ambiance d’autrefois. La mixité sociale apparaît en même temps que la montée du chômage. Les travailleurs issus de l’émigration sont les premières victimes de la désindustrialisation. En 1976 le seuil du million de chômeurs vient d’être franchi et les étrangers étaient accusés de voler le pain aux Français. C’était l’époque des bavures policières et des crimes racistes. Dans ce contexte La marche des beurs en 1983 pour l’égalité semble de bon augure. Elle exprimait un désir de changement qui faisait écho au slogan « Changer la vie » des socialistes. Le Président de la République, F. Mitterrand avait reçu une délégation des marcheurs à l’Elysée. Une carte de séjour de 10 ans avait été proposée aux travailleurs étrangers. Mais la République black- blanc-Beur dont on parlait à l’époque ne résiste pas à la situation économique qui se dégrade. Le sentiment d’insécurité monte qui va nourrir une nouvelle vague de racisme. Le Front National s’en nourrit : « les français d’abord. » Les bonnes dispositions au pouvoir changent. On ne veut plus exciter un électorat favorable aux thèses du front national. On oublie cette république black-blanc beur, on ferme les yeux sur ce qui se passe dans les cités. On laisse la situation pourrir peu à peu. Qu’ils se débrouillent entre eux, semble être le mot d’ordre. On ne veut plus voir le pourrissement des cités : le machisme, la montée du communautarisme, la violence à l’égard des femmes qui donnera l’affaire des tournantes. Il faudra attendre 20 ans, c’est-à-dire le début du XXI è siècle pour réaliser que le problème des banlieues est crucial dans notre société. De nombreux plans sont concoctés : Plan Marshall des banlieues, antiglandouille des jeunes, respect et égalité des chances, Espoir banlieue… Autant de termes qui infantilisent, stigmatisent. On a démoli les immeubles insalubres des années 60 pour reconstruire du neuf. Mais dans ce neuf, ce sont les classes moyennes qui se sont installées. On a simplement déplacé le problème en installant les pauvres dans d’autres immeubles aussi insalubres. La mayonnaise de la mixité sociale n’a pas été réussie. Une dizaine de secrétaires d’Etat et de ministres de la Ville se succèdent. Le jargon bureaucratique domine : les ZUS (zones urbaines sensibles) englobent les ZRU (zones de redynamisation urbaines), lesquelles comprennent les ZFU (zones franches urbaines) En vain : 40% des jeunes diplômés sont toujours au chômage… On n’a pas pu anticiper les émeutes de 2005. Les jeunes ont brûlé des édifices publics dont les écoles. Pourquoi l’école ? Parce que celle-ci n’est pas un vecteur de réussite sociale mais d’exclusion. Car la question est la suivante :
Comment faire en sorte que la société ne finalise pas l’inégalité sociale en échec scolaire ?
Il faut redonner du sens à l’éducation. Et pour cela il faut changer de paradigme… L’art de l’enseignant est peut-être moins dans la transmission des savoirs que dans sa mise en scène.
Philippe Mérieux écrit qu’il y a quelque chose d’ineffable dans la relation enseignante. Il y a deux niveaux dans la transmission des savoirs. L’un est basique : transmettre en donnant à l’élève les outils qui lui permettent d’accéder au savoir. Le second niveau est plus subtil, disons métacognitif. C’est par rapport à soi. Soi qui s’observe en train de réfléchir… Cela permet de savoir ce que l’élève sait, ne sait pas et quand il le sait, quand il ne le sait pas. N’oublions pas qu’un élève en difficulté l’est davantage sur la tâche que sur le sens. Dans ce second niveau il y a parfois des déclics. La plupart de nos élèves ont des blocages. Et puis un jour, parce qu’un prof est différent, parce qu’un livre leur a plu, ou bien parce qu’ils ont vécu une expérience valorisante, une porte s’ouvre puis une autre et ainsi de suite. Les élèves testent moins nos faiblesses que notre capacité à les sortir de la réalité. Ou bien à décomposer cette réalité, à la recomposer…
Transformer ainsi l’objet de la connaissance en couleurs en sensation… Afin que la représentation que se fait l’élève soit celle d’une traversée, d’une expérience sensible et non une représentation artificielle, officielle, celle du maître. On va me dire : mais comment transformer par exemple une discipline comme la compta ou la vente en chaleur en couleurs, en sensations. Eh bien, justement, rendre sensible cette traversée, c’est bien là l’art d’enseigner.
Mais je vais un peu loin…
La réforme du bac pro a été appliquée dès la rentrée 2009. Elle raccourcit le cursus de quatre à trois ans et supplante le BEP. Le gouvernement entend ainsi revaloriser une filière qui accueille chaque année le tiers des lycéens. Comment ? Les élèves du professionnel et du lycée général partiront au même coup de sifflet, en Seconde, et arriveront de concert en Terminale pour l’examen final. On élève ainsi la dignité du « Tiers monde de l’éducation » en abolissant d’un coup de baguette magique les différences de performances entre les sprinters. Avec cette réforme en trois ans on enlève une année aux élèves qui nous arrivent en Seconde à l’âge de 15 ans et à qui il faut trouver des stages.
On flatte l’inculture
Quelques élèves ont un fort potentiel mais pour des raisons de comportements marginaux se retrouvent en LP. C’est avec eux que l’on prend plaisir à animer, par exemple, des ateliers théâtre. Malheureusement il n’existe pas d’option théâtre en lycée professionnel. Les nouvelles réformes vont dans ce sens d’un appauvrissement de la culture. Par exemple, les heures en Arts appliqués ont été réduites à leur portion congrue. Les profs doivent évaluer les élèves en cours de formation, les CCF. Mais faute de temps, l’évaluation devient sans objet, vide de sens, purement administrative.
L’exigence au baccalauréat professionnel est réduite : le niveau en matière générale est celui d’une sixième de collège. Et guère plus élevé dans les disciplines professionnelles. On ne passe plus le BEP mais une certification, une sorte de peau de chagrin. On obtient la certification par le moyen du CCF (contrôle en cours de formation). En vente, par exemple, on donne le même exercice jusqu’à ce que l’élève réussisse et, s’il s’absente, on lui court derrière, on lui propose une autre date et on lui soumet la même épreuve : c’est du harcèlement pédagogique ! Et les profs n’en peuvent plus. Ils rendent l’inadmissible admissible. Ils souffrent pour certains car ils éprouvent une double contrainte, l’injonction paradoxale : avoir été formé pour enseigner, croire en certaines valeurs d’égalité, de justice et aggraver malgré eux cette injustice. Ils souffrent de devenir de simples agents du contrôle social : pacifier, se soumettre, et en définitive devant une classe hétérogène qui abrite des perturbateurs : de devoir sauver sa peau.
Dans les salles d’examen tout est fait et contrôlé pour que l’élève ait la moyenne pour satisfaire au quota de réussite : 80 % d’une classe d’âge au bac. Le barème à l’épreuve de français est fait de telle manière que tout le monde a la moyenne. Si l’élève n’a pas la moyenne, il passe l’oral de rattrapage non pas sur les matières où il a échoué, mais sur un compte rendu de son stage où il ne lui est pas difficile de rattraper ces points. Les élèves se sont donné le mot pour ce bac professionnel. Il est facile de l’obtenir.
Dans les programmes on sent que tout se vaut, NTM et Proust, une question de goût et de couleur comme l’intitule un objet d’étude en seconde. On tire les élèves par le bas. Pourtant certaines expériences de lecture ou de théâtre montrent que les élèves en difficulté sont sensibles à la beauté universelle.
La beauté n’est pas dévolue aux héritiers selon l’expression de Bourdieu, elle sommeille en chacun. C’est à nous enseignant de ne pas désespérer du niveau de nos élèves en prenant conscience de ce que nous avons en commun : une fragilité, un mystère. Si l’on cesse de croire au potentiel de ses élèves alors on risque une autre définition de l’homme : l’homme ignorant, l’homme stupide… Or, penser ainsi c’est mettre fin à l’exception humaine. Pour enseigner il faut toujours croire à ce mystère qui fait qu’un jour un élève se révèle à lui-même. Il ne faut donc jamais renoncer à l’excellence, à la complexité.
En quoi peut-on parler d’un Tiers Monde de l’éducation ?
 Il y a plusieurs types de LP, mais il est à craindre que les LP de banlieue forment ce Tiers Monde éducatif, c’est-à-dire un tiers exclu. Les élèves sont en difficulté mais rien de concret n’est fait pour les aider. On s’adapte à leur niveau pour obéir à un quota de 80% d’une classe d’âge au bac et même beaucoup plus. Le score des réussites au bac professionnel vient compenser une baisse des résultats au bac général. Baisser le niveau des exigences, offrir le baccalauréat, c’est tromper l’élève qui vient d’obtenir son diplôme et lui donner l’impression qu’il peut tout réussir désormais sans le moindre effort. C’est de la démagogie.
Il y a plusieurs types de LP, mais il est à craindre que les LP de banlieue forment ce Tiers Monde éducatif, c’est-à-dire un tiers exclu. Les élèves sont en difficulté mais rien de concret n’est fait pour les aider. On s’adapte à leur niveau pour obéir à un quota de 80% d’une classe d’âge au bac et même beaucoup plus. Le score des réussites au bac professionnel vient compenser une baisse des résultats au bac général. Baisser le niveau des exigences, offrir le baccalauréat, c’est tromper l’élève qui vient d’obtenir son diplôme et lui donner l’impression qu’il peut tout réussir désormais sans le moindre effort. C’est de la démagogie.
Mais quel intérêt a-t-on à laisser ce tiers monde éducatif se développer ? Il y a quelque chose qui perce dans tout cela : créer une forme de colonisation, le colonisé étant un sous-prolétaire intellectuel dont le système a besoin pour vendre des produits tous semblables à bas coût, au prix de revient des plus bas. C’est terrible de dire ça… J’en ai bien conscience.
Des mots comme objectifs, compétence… montrent combien l’esprit de l’entreprise a gagné celui de l’école. En lycée professionnel particulièrement la pédagogie de l’insertion a remplacé la pédagogie de l’émancipation. C’est un déni des classes populaires destinées à régresser sur le plan culturel. Cependant la professionnalisation ne sert à rien sans la culture qui permet de faire des choix. Elle seule facilite la formation d’un être libre, conscient des enjeux d’une société. Laisser se développer un tiers monde de l’éducation, un tiers exclu, qui produit des prolétaires acculturés nous conduit à lever le rideau sur les prochains spectacles pyrotechniques dans les cités, c’est s’engager aussi sur la voie des extrêmes et la politique du pire. L’école a perdu de son sens mais l’école a horreur du vide. L’école a besoin alors de créer l’événement. Mais quel événement ? Gageons que ce ne soit pas celui de son propre désastre… * Auteur de Requiem pour un émeutier, Actes Sud, 2010
Publications :
Dimitri Analis (1938-2012), poète de l’errance. Direction de la revue Le Lien, avec la participation d’Edgar Morin, Peter Handke, Anghelaki-Rooke… Librairie hellénique, Desmos, juin 2013
Requiem pour un émeutier. Essai, Actes Sud, 2010
Toute une nuit au Pirée. Nouvelles fantastiques, éd. l’Age d’Homme, 2008
JF aux semelles de vent, roman, Calmann-Lévy, 2004
Le Roi d’Asiné.
Roman, L’Age d’Homme, 1998
Sélection Prix des Ambassadeurs.
Anthologie de nouvelles grecques, Atelier du Gué, 1994
La Crète, Autrement/Seuil, 1993
La Grèce, Autrement/Seuil, 1989, 1991 (Traduit en Grec, éd. Gialelis)
Banlieue-brume (poèmes), Saint-Germain-des-Prés, 1978
Autres :
Collaboration à L’Atelier du roman, Flammarion, 2006
Critique littéraire, magazine Ecrire et Editer, 2000-2004
Nouvelles fantastiques dans revues et magazines, 1980-1990
Théâtre (Ecriture et mise en scène)
Petits arrangements avec… sur des textes de Sergi Belbel, Christian Cogné, Pascale Henry, Hanokh Levin et Jean-Gabriel Nordmann, Théâtre de l’Aquarium (Cartoucherie de Vincennes), juin 2012
Antigone de J. Anouilh, théâtre de l’Aquarium, Cartoucherie de Vincennes, juin 2011.
Les pas perdus de Denise Bonal, théâtre de l’Aquarium, juin 2010
Des étrangers plus mobiles que les vagues, de l’auteur, pièce jouée à la MC93 à Bobigny en mai 2008 et au théâtre Daniel Sorano à Vincennes, dans le cadre de l’atelier théâtre du lycée professionnel Jean-Moulin de Vincennes.
Human Bomb,
de l’auteur, Manuscrit.com, 2007
Bourse de la DMDTS (pour l’écriture et la mise en scène), pièce jouée en banlieue parisienne (Théâtre Berthelot, Montreuil-sous-Bois, nov.2003 ; Palais des Fêtes de Romainville, fév. 2005) et à Paris (Théo-Théâtre, déc. janv.2005). Sélection pour les Molières.